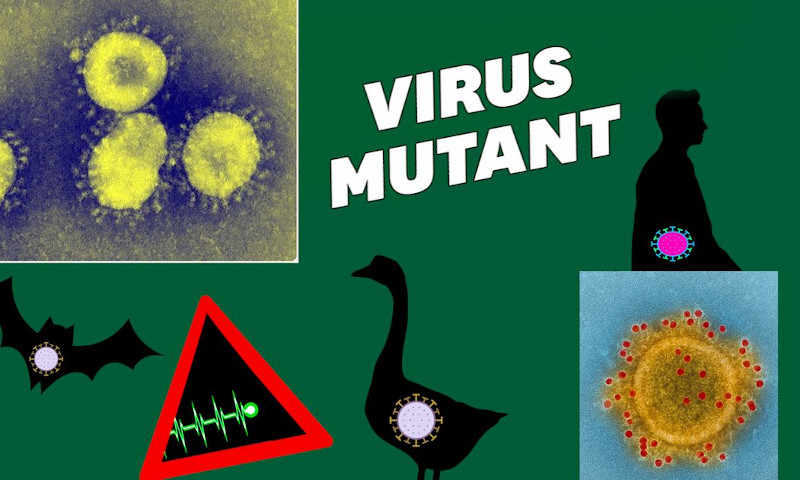C’est à qui lancera les paris les plus audacieux. Quelques mois? Quelques semaines peut-être? Entre les start-ups de la biotechnologie assoiffée de reconnaissance et les grands labos qui tiennent à la garder, la course au vaccin contre le coronavirus 2019-nCoV est bruyamment lancée. Pourtant, le pic de l’épidémie pourrait être derrière nous lorsque la précieuse formule arrivera dans les pharmacies.
Ces vingt dernières années et leur lot d’épidémies offrent en effet un tableau plus que contrasté sur l’issue de cette compétition au vaccin. Le SRAS en 2002, le chikungunya en 2005 ou la fameuse grippe A “H1N1” en 2009: autant d’exemples que les Français connaissent bien, mais dont le pic de danger est passé sans qu’il y ait eu recours à la vaccination, ou qu’elle ait été particulièrement utile dans le cas de la grippe A.
Scénarios alternatifs
Le SRAS, également un coronavirus détecté dans le Sud-Est asiatique, fournit un exemple que les autorités chinoises souhaitent répéter. Les mesures appliquées alors mêlaient des méthodes classiques et une extrême modernité, comme le détaillait en 2007 une enquête du journal de l’université d’Harvard.
Comme en 2020 mais à plus petite échelle, le gouvernement chinois avait exigé une quarantaine stricte, tout en utilisant l’informatique et l’analyse du génome pour cerner les foyers d’infection. Non seulement les zones à risque ont été particulièrement ciblées, mais les élevages soupçonnés d’être porteurs du virus ont été éliminés. À la fin de l’année 2003, le bilan de l’épidémie, contenue en quelques mois, est de 800 morts: des chiffres lourds, qui auraient été d’une autre magnitude si la contagion avait tourné à la pandémie.
Le virus de chikungunya, contre lequel la lutte continue dans le monde entier, a lui pu être contrôlé après une explosion du nombre de cas en 2005 sur l’île de la Réunion. En l’absence de vaccin, ce sont des mesures de lutte contre le porteur du virus, le moustique tigre, associées aux traitements des symptômes, qui ont permis de passer le pic de l’épidémie. Pour l’île, le bilan reste très important, avec plus de 200 décès en 2005-2006 dus au virus.
Un scénario bien moins sombre attendait l’Hexagone (et tout l’hémisphère nord) dans le cas de la grippe A H1N1. Cette fois, les vaccins antigrippaux étaient prêts... mais c’est le virus lui-même qui s’est affaibli en arrivant en Europe. De syndrome respiratoire aigu, transmis par des porcs asiatiques, la maladie s’est muée en une simple grippe classique. Cette fois, ce ne fut pas seulement la ministre de la Santé de l’époque Roselyne Bachelot mais de nombreux gouvernements occidentaux qui ont dû gérer un stock gigantesque de traitements inutilisés.
Loin d’être anecdotiques, ces exemples rappellent que la recherche d’un vaccin alors qu’une épidémie a déjà commencé est une entreprise risquée, et dont les bienfaits potentiels sont en concurrence avec d’autres mesures sanitaires à l’effet immédiat.
Des annonces aux effets désastreux
Certains vaccins sont faciles à mettre au point parce que le virus à cibler est bien connu, comme le vaccin contre la grippe. Pour un coronavirus comme 2019-nCoV, en revanche, c’est un véritable défi. “Il faut d’abord identifier, puis mimer le virus, avant d’imaginer la formulation du vaccin. Il faut tester celle qui provoque la meilleure réponse immunitaire. À cette étape, les possibilités sont extrêmement nombreuses” explique François Cosset, chercheur au Centre international de recherches en immunologie de Lyon.
L’enthousiasme des nouveaux venus de la biotech et de certaines institutions peut alors sembler prématuré. Le CEPI, une association norvégienne qui fédère des acteurs privés et publics de la santé, a annoncé être capable de développer un vaccin en 16 semaines. Côté français, on estime déjà avoir un vaccin prometteur, estimant que des tests cliniques pourront commencer d’ici trois mois. Mais attention à l’emballement. “Les annonces de solutions miracles en un temps record peuvent avoir des effets désastreux” s’inquiète l’expert.
La route de production d’un vaccin est semée d’embûches, même lorsque la formule idéale paraît avoir été obtenue en labo. Un vaccin peut ainsi échouer très tard lors des tests, comme en 2012, lorsqu’un vaccin potentiel contre le SRAS avait montré lors de tests sur des rongeurs qu’il attaquait leur système immunitaire.
“Développer un vaccin reste fondamental et utile”, tempère François Cosset, même si l’entreprise n’est pas forcément la parade en cas d’épidémie. Même si la production d’un vaccin arrivait dans un second temps, il permettrait d’éradiquer pour de bon la maladie en traitant préventivement les populations à risque. Pour les deux cousins de 2019-nCov que sont les SRAS et MERS (qui sévissent au Moyen-Orient), il n’y a toujours pas de vaccin: bien qu’ils ne soient plus aussi meurtriers, ils resurgissent par vagues, laissant des centaines de morts derrière eux.
C’est sans doute dans cette résurgence que s’illustre le problème de l’excitation autour de la découverte possible d’un vaccin. Lorsque l’épidémie est à son pic, tous les efforts se portent sur la découverte d’un traitement. Mais alors que le plus gros du danger est passé, les financements se tarissent, comme dans le cas du SRAS. Or pour que ces efforts aboutissent, c’est souvent non en mois, mais en années qu’il faut compter.
HUFFPOST/Gisèle Mbuyi/DC
(GM/Yes)